Un patrimoine castral exceptionnel dans le Nord-Pas-de-Calais
- Lézard Amusé

- 20 mars 2020
- 7 min de lecture
Dernière mise à jour : 14 mai 2020
Les demeures seigneuriales dans le Nord-Pas-de-Calais ne sont pas nombreuses, mais elles restent néanmoins très bien conservées. Certaines ont des éléments d’architecture en commun, typiques des demeures médiévales, mais chacune a une histoire unique à raconter. Voici un petit panorama de cinq lieux dont l’histoire mérite d’être contée…
Le Donjon de Bours
Fièrement dressé sur sa motte, le donjon de Bours reste l’un des seuls témoignages, dans le Nord de la France, d’un logis seigneurial prenant la forme d’un donjon.
Les premières mentions des seigneurs de Bours apparaissent à la fin du XIIème siècle, dans une charte dans laquelle un chevalier nommé Adam de « Boors » engage la dime aux frères hospitaliers de Haute-Avesnes. Au fur et à mesure, les seigneurs de Bours ont constitué un large patrimoine grâce aux nombreux hameaux et terres qu’ils possèdent.
Entièrement en grès, le donjon tel qu’il nous est parvenu aujourd’hui date du XIVème siècle (mention dans une charte de 1375). Le domaine de Bours est constitué d’une haute et basse-cour. Le donjon est, comme la majorité des châteaux et autres demeures seigneuriales, entouré de douves et de fossés. Les Bours auront autorité sur le domaine jusqu’en 1390, il passera ensuite à la famille Mailly jusqu’en 1516. D’autres familles se succéderont par la suite.
Ce donjon n’a aucune vocation à être un bâtiment défensif : on n’y voit aucune muraille, aucun mâchicoulis percé pour lancer des projectiles sur les ennemis. Au contraire, il est conçu pour qu’une famille seigneuriale puisse y habiter. Le terme de maison forte est donc plus appropriée, car un donjon se comprend normalement dans un ensemble castral défensif alors que celui de Bours ne l'est pas.
Le donjon est flanqué de six tourelles cylindriques en encorbellement (construction en saillie sur le pan d'un mur) : quatre des tours se situent aux angles, tandis que les deux dernières prennent place au nord et sud de l’édifice. Deux accès étaient possible : un menant directement au cellier, lieu de stockage de l’ensemble des denrées nécessaires à la vie quotidienne, et un autre pour accéder à la salle noble, lieu de vie du seigneur et de ses proches.
Au XVIème siècle, le domaine va être ravagé par les flammes mais fort heureusement, la tour est sauvée partiellement. En effet la structure, épaisse et robuste, résiste, mais l’intérieur est fortement endommagé. Des travaux sont effectués pour lui rendre tout son charme. La façade est en partie reconstruite avec des moellons de silex, un nouvel accès au cellier est percé dans le mur après son effondrement et un nouvel escalier est construit pour accéder à la salle noble.
La première représentation du donjon est visible dans les Albums du Croÿ, réalisés entre la fin du XVIème et le début du XVIIème siècle. Bien sûr, les proportions ne sont pas réalistes mais on arrive à deviner, au loin, la présence de douves, d’un pont et de plusieurs autres bâtiments.

Classé monument historique depuis 1965, il a fait l’objet récemment de nombreuses fouilles qui ont permis de retrouver de multiples objets du quotidien, laissés sur place. De nombreuses restaurations effectuées depuis 2011, ont permis, en juin 2019, que le lieu redevienne accessible au public. Une nouvelle passerelle a été installée pour l’occasion.
Adresse : 29 rue de l’Église, 62550 Bours
Le château de Créminil
La construction de cette demeure a été voulue par Jean Le May, seigneur de Cresmainil, en 1443. Ce « manoir de craie », qui tire son nom de ses fondations en pierres calcaires (« Cré » signifiant craie et « Minil » manoir) semble immergé de l’eau. Il est entouré de douves profondes qui rendent difficile son accès. Seul un pont-levis permet de pouvoir pénétrer dans l’épaisse bâtisse (les murs ont une épaisseur allant de 80 à 120 cm), la porte d’entrée est inscrite dans un arc brisé, encadrée de deux massives tours de garde. Prenant la forme d’un polygonale irrégulier, le château présente douze pans de murs, habillés de multiples tourelles en encorbellement et contreforts (piliers massifs qui permettent de soutenir le poids d'un mur). Il avait vocation à défendre contre les assauts ennemis.
Malgré le fait qu’il fut de nombreuses fois saccagé et remanié entre les XVI et XVIIIe siècles (le château présentait à l’origine une forme circulaire complète mais à la fin du XVIIIe, on a décidé d’ouvrir la muraille sud pour avoir une vue dégagée sur le jardin), celui-ci n’a rien perdu de sa superbe.
En 2001, les propriétaires ont décidé de créer un jardin d’inspiration médiévale. Celui-ci, délimité par une haie ou un mur, présentait plusieurs parcelles de plantes utilisées pour la préparation des repas, connues pour leurs vertus médicinales ou pour leur teinte.
Pour le choix des plantes, ils se sont inspirés du Capitulaire de Villis, réalisé vers 795 (il recense les plantes dont on demande la culture sur les domaines de l’empereur Charlemagne) et des Grandes Heures d’Anne de Bretagne, dont les pages sont ornées d’enluminures très soignées, représentant les merveilles issues de la Faune et de la Flore. Ainsi, près de 337 plantes ont pu être identifiées. Au Moyen âge, chaque fleur et plante ont une symbolique.

Adresse : 11 rue de la Mairie, 62145 Estrée-Blanche
Le château d’Olhain
Comme pour le château de Créminil, Olhain aussi flotte sur l’eau. Plus précisément, il repose sur un îlot rond, de même pour la vaste basse-cour qui nous accueille dès l’entrée, avec ces nombreux communs, qui servaient aussi de lieu de protection des habitants en cas d’attaques. L’ensemble du domaine a été édifié vers 1200 par Hugues d’Olhain, un croisé au service du roi qui prit part au siège de Constantinople. Il n’a guère changé depuis le XVème siècle.
Après avoir franchi le pont levis (à l’origine, il y en avait trois), le visiteur est tout de suite accueilli par deux imposantes tours, qui gardent l’entrée du château, lui-même cerclé d’une épaisse muraille de pierre. Une tour de guet culmine à plus de 30 mètres de hauteur, et est accolée à un donjon. Au premier étage de celui-ci, on trouve la Salle des gardes, voûtée d’ogives (un arc placé en diagonale). Sur la clef de voûte, est taillé l’insigne de l’Ordre de la Toison d’Or, instauré par Philippe le Bon (1396-1467), duc de Bourgogne, en 1430.
Abîmé pendant la guerre de Cent Ans (1337-1453), il sera restauré et remanié en 1407 par Marie d’Olhain et son époux, Jean de Nielles, proche conseiller de Jean sans Peur, duc de Bourgogne (1371-1419) puis du roi Charles VI (1368-1422). Grâce aux époux Nielles, le château sera doté d’ouvrages défensifs élaborés pour une meilleure protection. Malheureusement, cela ne suffira pas à le protéger comme le témoigne une attaque espagnole, en 1654, qui détruisit les deux tours ouest du château.
Le château, ouvert à la visite en 1954, est aujourd’hui la propriété d’agriculteurs qui s’affairent à prendre soin de l’édifice et à exploiter les terres.
Adresse : Hameau d’Olhain, 19 rue Léo Lagrange, 62150 Fresnicourt-le-Dolmen
Le château-musée de Boulogne sur Mer
Le château de Boulogne-sur-Mer a été construit par Philippe Hurepel (1200-1234), dit aussi le hérissé, fils du roi de France Philippe II Auguste (1165-1223). Il reçut la ville de Boulogne part son père, après la victoire de celui-ci à Bouvines en 1215.
Aujourd’hui, à l’entrée du château, une copie d’une inscription ancienne fait état de la construction : « Philippe, comte de Boulogne, fils du roi Philippe de France , fit faire ce château et fermer la ville l’an de l’Incarnation 1231.» Le château prend la forme d’un polygone à neuf cotés, il ne possède pas de donjon mais quatre tours. Il a deux accès : un donnant vers la ville et l’autre vers la campagne. Après s’être rebellé un temps contre la régence de Blanche de Castille (1188-1252) à la fin des 1220, le Hurepel fortifia son territoire par la construction de deux autres châteaux : ceux de Calais et d’Hardelot.
Au XVIeme siècle, on le modernise ainsi que ses fortifications : une partie de la maçonnerie est doublée. Mais perdant peu à peu son intérêt stratégique, au XVIIe siècle, le château est transformé en caserne et en prison aux XVIIIe et XIXe siècles. Il garde sa vocation carcérale jusqu’en 1974 puis subit de nombreux travaux pour devenir le musée de la ville en 1988.
Adresse : rue du Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer
Le château d’Esquelbecq
En plein cœur de la Flandre, se dresse à Esquelbecq (signifiant « le ruisseau de chênes et faisant référence à l’implantation de chênes dans le Houtland), un château construit à la fin du XVIe siècle. Pourtant, la première attestation d’une motte féodale date du IXe siècle et la seigneurie d’Esquelbecq a été citée dans des documents généalogiques à partir du XIIIe siècle.
Pendant la guerre d’indépendance des Pays-Bas contre l’Espagne au XVIe siècle, la région fut durement touchée. Un certain Valentin de Pardieu s’activa avec des proches à faire reconstruire le village et le château. La plus ancienne date retrouvée sur l’édifice est 1590.
Typique de l’architecture flamande, le château a quatre pans, et est habillé de huit tourelles. Certains de ses murs pignons sont à pas de moineaux et l’ensemble de la structure est décorée d’un liseré de pierres blanches à mi-hauteur. La demeure, entourée de profondes douves, possède deux ponts pour pouvoir y accéder.
La dernière restauration générale de la bâtisse et des communs date de 1606. On pouvait apercevoir cette date sur le haut donjon (près de 126 marches), aujourd’hui disparu après son effondrement en 1984, et sur le colombier à bulbe. À cette époque, de nombreuses fenêtres avaient été rajoutées pour rendre cette demeure plus agréable à habiter.
Une gravure de 1644 nous montre que le château n’a guère changé depuis. On y voit également le raffinement des jardins à la flamande, auquel le propriétaire actuel et son équipe de bénévoles tentent de redonner vie. En 2017, il reçut le Prix Villandry, qui récompense la restauration du jardin, du potager et la serre à vignes de 1860.
Classés au titre des Monuments Historiques, le château, le jardin et le parc continuent d’être le théâtre d’animations, d’expositions d’art contemporain et de fêtes autours des jardins. Prochain événement à inscrire sur votre agenda, la Journée des Plantes les 18 et 19 avril 2020.
Adresse : rue de la Gare, 59470 Esquelbecq
À la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, les châteaux perdront peu à peu leur caractère défensif : on abandonne progressivement les murailles, les meurtrières, les douves... Ils deviennent de véritables lieux de plaisance, qui allient art et délectation.
On espère que ce petit article vous aura plu :-) Les arts à musées vous en concoctent pleins d'autres ! En attendant, prenez bien soin de vous.




















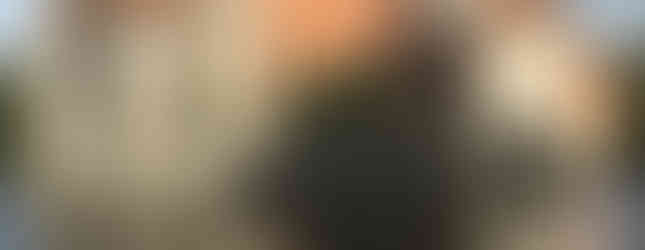




























Commentaires